Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023, JO du 11

Grâce au dispositif IR-PME, les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Précision : les versements au titre de la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.
Fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 %, notamment pour les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022. Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, les pouvoirs publics avaient acté la reconduite de cette majoration pour l’année 2023. Toutefois, pour pouvoir être effective, cette dernière devait être déclarée conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Ainsi, les pouvoirs publics, via un décret, viennent de fixer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 12 mars 2023. À compter de cette date et jusqu’à la fin de l’année, les contribuables peuvent donc profiter de cet avantage fiscal.

Les particuliers qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de ces versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux étant porté à 75 % pour les dons, retenus dans la limite de 1 000 €, aux associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuent à favoriser leur logement ou, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.
Par ailleurs, les dons consentis à certains organismes d’intérêt général (associations intermédiaires, entreprises adaptées, ateliers et chantiers d’insertion…) ouvrent droit pour les contribuables redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à une réduction d’impôt de 75 % du montant des dons, une réduction plafonnée à 50 000 €.
Pour que ces contribuables bénéficient de leur avantage fiscal, les associations doivent leur délivrer un reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration (n° 2041-RD).
Un modèle qui vient d’être mis à jour ( ).
À savoir : l’association n’est pas contrainte d’utiliser le formulaire de reçu établi par l’administration. Toutefois, le reçu qu’elle délivre doit comporter toutes les mentions figurant sur ce modèle.
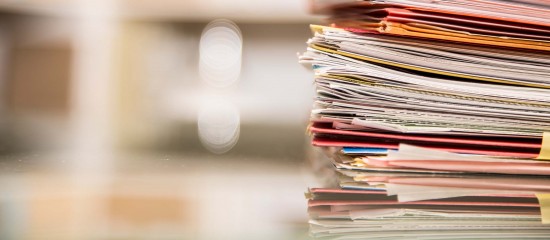
Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) selon un régime réel (normal ou simplifié) doivent, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023. Il en est de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022. Pour rappel, les entreprises qui ont demandé un examen de conformité fiscale pour 2022 doivent cocher la case « ECF » dans leur déclaration de résultats et identifier le professionnel qui en est en charge.
Attention : le défaut ou le retard de déclaration donne lieu à un intérêt de retard (0,20 %/mois), à une majoration de droits d’au moins 10 % ainsi qu’à une évaluation d’office si la déclaration n’est pas produite dans les 30 jours qui suivent une première mise en demeure.
Les déclarations n° 1330-CVAE et Decloyer (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023. En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites pour le 3 mai 2023 (cf. tableau ci-dessous).
À noter : initialement annoncée pour 2023, la suppression de la CVAE est finalement programmée sur 2 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2024.
Cassation civile 3e, 16 novembre 2022, n° 21-18527

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.
Précision : si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.
À ce titre, les juges ont estimé récemment que l’épouse d’un exploitant qui participait aux travaux de l’exploitation agricole depuis plus de 5 ans au moment du décès de ce dernier remplissait bien la condition pour bénéficier de la continuation du bail rural à son profit quand bien même elle ne s’était mariée avec l’intéressé que quelques jours avant le décès.
Dans cette affaire, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail, faisant valoir que l’épouse de l’exploitant décédé n’était pas en droit de prendre la suite de ce dernier comme titulaire du bail rural puisqu’elle ne s’était mariée avec lui que 49 jours avant le décès et qu’elle ne remplissait donc pas la condition d’une participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans en qualité de conjoint.
Mais la Cour de cassation, jusqu’à laquelle le litige avait été porté, n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté qu’au jour du décès de l’exploitant locataire, la veuve était l’épouse de ce dernier et qu’elle participait de manière régulière et effective à l’exploitation depuis plus de 5 ans. Pour les juges, elle était donc en droit de bénéficier du statut de preneur à bail dont son conjoint était titulaire, peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant le décès.
Commentaire : pour bénéficier de la continuation du bail rural, il n’est donc pas nécessaire que la participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans l’ait été en qualité de conjoint. Ce qui importe, c’est que la qualité de conjoint (ou de partenaire de Pacs d’ailleurs) existe au moment du décès du locataire.
Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

Vous le savez sans doute, mais il n’est peut-être pas inutile de le rappeler : la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces sera interdite à compter du 1 avril prochain. Un certain nombre de dérogations sont toutefois prévues. Explications.
Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février
Foire aux questions du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion

Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie établi par les pouvoirs publics.
Au 1 janvier 2025, tous les employeurs devront utiliser un nouveau modèle de bulletin de paie récemment défini par arrêté. Un modèle refondu notamment quant à la présentation des cotisations et contributions sociales. De plus, il comportera une nouvelle rubrique consacrée aux « remboursements et déductions diverses » qui concernera notamment les frais de transports, les titres-restaurant et les chèques-vacances.
Jusqu’à cette date, les employeurs pourront continuer d’utiliser le modèle actuel de bulletin de paie. Un modèle qui, à compter du 1 juillet 2023, devra intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social (ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement des salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires à la charge du salarié).
Précision : pour les salariés non concernés par certaines cotisations, il est possible d’afficher dans le bulletin de paie uniquement les lignes donnant lieu au calcul et à la déclaration de cotisations. Ainsi, par exemple, la ligne Apec n’apparaît que sur les bulletins de paie des salariés cadres.
Nous vous présentons ci-dessous ces deux nouveaux modèles de bulletin de paie. Sachant qu’ils peuvent être utilisés avant leur date obligatoire d’entrée en vigueur.
Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-13647

Les tribunaux peuvent prononcer une mesure d’interdiction de gérer une personne morale à l’encontre des dirigeants d’une association placée en redressement ou liquidation judiciaire lorsque ceux-ci ont commis certaines fautes dans la gestion de cette structure (utilisation des biens de l’association comme les leurs, poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de l’association, détournement de l’actif de l’association…).
Dans une affaire récente, une association de service et de soins d’aide à domicile avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors recherché en justice la responsabilité pour insuffisance d’actif de la directrice de l’association, en qualité de dirigeante de fait, et demandé que soit prononcée contre elle une mesure d’interdiction de gérer.
Estimant que la directrice n’avait pas effectué de suivi juridique de l’association et qu’elle avait poursuivi une activité déficitaire, la cour d’appel l’avait sanctionnée d’une interdiction de gérer d’une durée de 2 ans. Une sanction qui a toutefois été annulée par la Cour de cassation.
En effet, la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou toute personne morale ne peut être prononcée que dans des cas limitativement énumérés par le Code de commerce.
Or l’absence de suivi juridique de l’association ne fait pas partie de l’énumération des fautes susceptibles d’entraîner une interdiction de gérer. En outre, la poursuite abusive d’une activité déficitaire de l’association ne peut être sanctionnée que si elle ne peut conduire qu’à la cessation des paiements et que son dirigeant en retire un intérêt personnel. Deux conditions que la cour d’appel n’avait pas pris la peine de démontrer.
Conseil d’État, 27 octobre 2022, n° 453264

Les déficits provenant d’activités non commerciales ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable, excepté ceux issus d’une activité libérale, mais à condition, dans ce cas, que l’intéressé exerce effectivement cette activité libérale à titre professionnel.
C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État. Dans cette affaire, un médecin spécialiste en radiologie avait acquis des parts d’une société civile immobilière (SCI) qui donnait en sous-location les murs de la clinique dans laquelle il exerçait son activité. Le médecin avait demandé la déduction des déficits issus de l’activité de cette SCI de son revenu global, à hauteur de la quote-part qui lui revenait en tant qu’associé.
Ce que lui a refusé le Conseil d’État dans la mesure où l’activité de sous-location d’immeubles nus, qui ne requiert pas la mise en œuvre d’un art ou de savoir-faire particuliers, ne constitue pas une activité libérale. Et peu importe que cette activité soit exercée à titre professionnel.
www.impots.gouv.fr, actualité du 2 février 2023

Les cessions de droits sociaux qui ne sont pas constatées par un acte signé entre les parties ou devant notaire doivent normalement être déclarées dans le mois suivant leur réalisation au service des impôts. Cet enregistrement s’accompagnant du paiement de l’imposition correspondante.
Nouveauté, les entreprises peuvent désormais déclarer en ligne ces cessions, sauf exception. Sont concernées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière.
Précision : jusqu’à présent, ce service de déclaration en ligne était réservé aux particuliers.
Cette télédéclaration peut être effectuée par le cessionnaire ou par le cédant des droits sociaux, sur son espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Et attention, une fois validée, la déclaration n’est plus modifiable mais seulement consultable. Si un impôt est dû, son paiement peut également s’opérer en ligne soit par carte bancaire, soit par prélèvement.
En pratique : si le déclarant agit pour le compte de sa propre entreprise, l’adhésion au service en ligne est automatique. En revanche, s’il représente une entreprise ou intervient pour le compte de plusieurs entreprises, il doit au préalable demander l’adhésion au service et choisir le numéro SIREN de l’entreprise concernée. Après validation de l’adhésion, l’entreprise recevra un courrier par voie postale contenant un code d’activation, valable 60 jours, qu’elle devra communiquer au déclarant.
Pour l’heure, le recours à la déclaration en ligne reste facultatif. Cependant, les déclarations de cessions de droits sociaux devront obligatoirement être souscrites par voie électronique, et l’imposition correspondante obligatoirement payée en ligne, au plus tard à compter du 1 juillet 2025.
Cassation sociale, 1er mars 2023, n° 21-12068

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps doit être rémunéré par l’employeur et être intégré dans le décompte des heures supplémentaires et dans celui des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.
Selon le Code du travail, le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un salarié et le lieu d’exécution de son contrat de travail (client, autre établissement de l’employeur, fournisseur, chantier, etc.) ne constitue pas du temps de travail effectif. S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail (pour un salarié qui se rend chez un client éloigné, par exemple), ce dernier perçoit une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Récemment, la Cour de cassation a toutefois décidé que, par exception, ce temps de déplacement professionnel constitue du temps de travail effectif dès lors que le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. C’est le cas, par exemple, lorsque, pendant ce trajet, le salarié doit, avec son téléphone professionnel et le kit mains libres installé dans la voiture de l’entreprise, fixer des rendez-vous clients et répondre aux appels de ses collègues et des clients.
Une solution que la Cour de cassation vient d’appliquer dans une nouvelle affaire. Ainsi, un technicien de maintenance dans une entreprise de réparation de machines et d’équipements mécaniques avait réclamé en justice le paiement d’heures supplémentaires correspondant aux déplacements effectués avec un véhicule de service entre son domicile et ses lieux d’intervention chez les clients de l’entreprise.
La cour d’appel avait rejeté cette demande. Mais pour la Cour de cassation, les conditions dans lesquelles le salarié effectuait ces trajets montraient plutôt l’existence d’un temps de travail effectif : le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour ses opérations de maintenance, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients.
Communiqué de presse du gouvernement du 2 mars 2023

Un fonds de garantie « énergie » vient d’être instauré pour permettre aux entreprises fortement consommatrices de gaz et d’électricité de demander à des banques, à des entreprises d’assurance ou à des sociétés de financement de bénéficier de cautionnements partiellement garantis par l’État pour leurs contrats de fourniture d’énergie, en remplacement des garanties demandées par les fournisseurs d’énergie.
Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 22 février 2023

Selon l’Insee, plus de 21 000 communes françaises ne disposent d’aucun commerce, soit 62 % d’entre elles (25 % en 1980) ! Ce manque fragilise l’attractivité du territoire rural, détruit les liens sociaux et entraîne des déplacements émetteurs de CO2. Pour renverser cette tendance, l’État vient de lancer un programme de « reconquête du commerce rural ». Doté d’une enveloppe de 12 M€ pour 2023, ce dispositif vise les communes qui sont dépourvues de commerces, ou dont les derniers commerces ne répondent plus aux besoins de première nécessité de la population.

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage...) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations.
Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit 2 051,14 € depuis le 1 janvier 2023), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic (entre 2 051,14 € et 2 734,85 € depuis le 1 janvier 2023) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel.
Cette exonération s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit 2 734,85 € brut par mois depuis le 1 janvier 2023).
En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à cette réduction au titre de l’année 2022 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole au plus tard le 31 mars 2023.
Conseil d’État, 23 septembre 2022, n° 458597

Une entreprise qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal peut contester le redressement envisagé en adressant une réclamation à l’administration. Sachant que cette réclamation doit, en principe, être présentée au plus tard le 31 décembre de la 3 année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification.
À noter : la réclamation peut porter tant sur les impositions supplémentaires établies à la suite de la proposition de rectification que sur les impositions initiales visées par la procédure.
À ce titre, la question s’est posée de savoir si une réclamation postée le jour de l’expiration du délai imparti, et donc reçue postérieurement par les services fiscaux, était valable.
Oui, a jugé le Conseil d’État, qui a rappelé que le respect du délai s’apprécie par rapport à la date d’envoi de la réclamation par le contribuable, et non par rapport à sa date de réception par l’administration. Une réclamation peut donc valablement être envoyée jusqu’au dernier jour de la date limite. Ainsi, par exemple, une réclamation formulée pour contester une proposition de rectification notifiée en 2020 peut être postée au plus tard le 31 décembre 2023, peu importe qu’elle soit réceptionnée ultérieurement par l’administration.
En pratique : il est conseillé d’envoyer une réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la Poste faisant foi, afin d’être en mesure de prouver sa date d’envoi.

Dans le cadre du volontariat associatif, les associations peuvent accueillir un volontaire âgé d’au moins 25 ans pour une mission d’intérêt général. Sachant que les dirigeants bénévoles d’une association y sont éligibles.
Cassation sociale, 8 février 2023, n° 21-14444
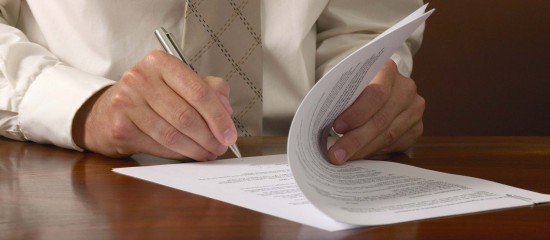
Un contrat à durée déterminée (CDD) doit être conclu par écrit et contenir certaines mentions obligatoires, au risque d’être requalifié par les tribunaux en contrat à durée indéterminée (CDI). À ce titre, un CDD destiné à remplacer un salarié absent doit indiquer le nom et la qualification professionnelle de ce salarié.
Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en CDD pour remplacer un salarié en congés payés. Le CDD mentionnait qu’il était recruté en qualité de « conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 qualification : ouvrier » ainsi que le nom du salarié absent. Constatant que la qualification du salarié qu’il remplaçait n’était pas indiquée, le salarié en CDD avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son contrat en un CDI.
La Cour de cassation a fait droit à sa demande. En effet, le Code du travail exige que le CDD de remplacement précise, à la fois, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé. L’absence de l’une ou l’autre de ces mentions entraîne donc la requalification du CDD en CDI.
Précision : pour la Cour de cassation, la qualification professionnelle du salarié remplacé ne peut pas être déduite de celle du salarié recruté en CDD.
Rép. min. n° 2235, JOAN du 7 février 2023

En principe, le patrimoine d’un défunt est soumis à la fiscalité du lieu de son domicile fiscal. Mais lorsqu’il possède des biens dans un autre pays, ses héritiers peuvent être confrontés à la question de la double imposition au titre des droits de succession. Afin d’éviter ce phénomène de double imposition, la France a conclu des conventions fiscales bilatérales avec de nombreux États. Ces conventions permettant notamment de déterminer la manière dont seront imposés les biens.
À ce titre, dans le cadre de discussions parlementaires, un député a interpellé les pouvoirs publics sur le fait que certains Français, qui vivent en France et héritent d’un proche résidant en Suisse et possédant des biens meubles ou immeubles en France, doivent faire face à une double imposition. Une situation qui résulte de la dénonciation, en 2014, par la France de la convention fiscale entre la République française et la Confédération suisse, qui avait été signée le 31 décembre 1953. Ce parlementaire a souhaité savoir si la France avait l’intention d’établir une nouvelle convention entre les deux pays.
En réponse, le ministre de l’Économie et des Finances a souligné que cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession car elle créait des situations de non-imposition et d’optimisation au détriment des finances publiques françaises. S’agissant de successions « internationales » relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à les imposer au profit d’un autre État. La dénonciation de la convention a été publiée le 24 décembre 2014 et a donc cessé de produire ses effets au 1 janvier 2015. C’est donc désormais la législation française qui s’applique intégralement.
Enfin, le ministre précise que si la France dispose d’un vaste réseau conventionnel puisqu’elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d’élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (au nombre de 33). Ceux-ci sont généralement anciens car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n’a, par conséquent, rien d’exceptionnel.
Cassation sociale, 1er février ,2023, n° 20-19661

Les employeurs sont autorisés à procéder à des licenciements pour motif économique notamment lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (EBE), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Et si en la matière, le Code du travail précise bien ce qu’il faut entendre par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (à savoir une baisse constatée sur un ou plusieurs trimestres par rapport à la même période de l’année précédente), il ne dit rien quant à l’application des autres critères comme la dégradation de l’EBE. Il revient alors aux juges d’apprécier le caractère durable et sérieux de cette dégradation afin d’en déduire, ou non, l’existence de difficultés économiques.
Dans une affaire récente, une directrice d’hébergement avait été licenciée pour motif économique en raison de la diminution de l’EBE de la société qui l’employait. Elle avait toutefois contesté en justice le motif économique de son licenciement. Et pour cause, si la société avait vu son EBE se dégrader, elle avait, dans le même temps, enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires.
Amenés à se prononcer dans ce litige, les juges d’appel avaient relevé que l’EBE de la société s’était dégradé sur plusieurs années (-726 000 € en 2014, -874 000 € en 2015…). De sorte que cette dégradation présentait un caractère durable et sérieux et que l’EBE de la société avait bien connu une évolution significative. La société, qui était confrontée à des difficultés économiques, était alors fondée à prononcer un licenciement économique. Une décision qui a, par la suite, été confirmée par la Cour de cassation.
Précision : les juges n’ont pas retenu l’argument de la salariée qui invoquait une augmentation du chiffre d’affaires de la société. En effet, dans une affaire antérieure, ils avaient déjà indiqué que même en l’absence d’une baisse du chiffre d’affaires (ou des commandes), les difficultés économiques d’une entreprise peuvent découler de l’évolution significative d’un autre indicateur économique, comme la dégradation de l’EBE ( ).
BOI-BIC-RICI-10-170 du 8 février 2023

Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€) qui ont réalisé certains travaux de rénovation énergétique (isolation thermique, pompe à chaleur, ventilation mécanique, etc.) dans leurs locaux, entre le 1 octobre 2020 et le 31 décembre 2021, ont pu bénéficier d’un crédit d’impôt. Bonne nouvelle : cet avantage fiscal, qui n’avait pas été reconduit ensuite, a été rétabli par la dernière loi de finances pour les dépenses engagées entre le 1 janvier 2023 et le 31 décembre 2024.
Précision : les bâtiments dans lesquels sont réalisés les travaux doivent être achevés depuis plus de 2 ans, dédiés à un usage tertiaire et affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie. Son montant ne peut toutefois excéder 25 000 €. À ce titre, l’administration fiscale a confirmé que ce plafond de 25 000 € est global et concerne les deux périodes d’application du dispositif (2020-2021 et 2023-2024). Autrement dit, le rétablissement du crédit d’impôt pour les dépenses engagées entre le 1 janvier 2023 et le 31 décembre 2024 ne peut pas profiter aux entreprises qui en ont déjà bénéficié pour des dépenses engagées entre le 1 octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et qui ont, à cette occasion, atteint le plafond.
À noter : les dépenses de rénovation énergétique engagées en 2022 ne peuvent pas ouvrir droit à l’avantage fiscal, le dispositif n’étant pas applicable pendant cette période.
Étude Injep n° 64, janvier 2023

Selon une enquête de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), les deux tiers des Français sont impliqués dans la vie des associations, soit en tant qu’adhérent, participant, bénévole ou donateur, soit en cumulant ces différentes casquettes.
Pour la moitié d’entre eux, leur implication est motivée par la convivialité ou la rencontre de personnes ayant les mêmes préoccupations. Suivent le souhait d’aider des personnes en difficulté et de se rendre utile à la société (43 %) et la défense d’une cause (34 %).
Les personnes qui ne s’investissent pas dans les associations invoquent, quant à elles, le manque de temps en raison de contraintes familiales ou professionnelles (un tiers d’entre elles) et le manque d’intérêt (24 %).
À noter : l’héritage familial est un déterminant essentiel. Ainsi, les deux tiers des Français dont la famille donne à des associations sont eux-mêmes donateurs (contre 42 % pour les autres).
Art. 25, loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, JO du 25

Une vente au déballage doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune sur le territoire de laquelle elle a lieu. Rappelons qu’une vente au déballage est une vente de marchandises réalisée dans des locaux ou sur des emplacements qui ne sont pas destinés à la vente au public ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Il s’agit donc de ventes ponctuelles qui ont lieu en dehors des magasins dans lesquels ces marchandises sont habituellement commercialisées.
Et attention, le fait de procéder à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée, ou en méconnaissance des termes de la déclaration, est passible d’une amende pénale pouvant aller jusqu’à 15 000 € si le contrevenant est une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale (une société).
Décret n° 2023-70 du 6 février 2023, JO du 7

Afin de lutter contre la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés agricoles, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a instauré un dispositif spécifique : l’essai encadré. Un dispositif dont les modalités d’application viennent enfin d’être précisées par décret.
Important : cette mesure s’applique aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal, aux collaborateurs d’exploitation, aux aides familiaux, aux associés d’exploitation et aux salariés agricoles (y compris les apprentis ou les stagiaires de la formation professionnelle).
L’essai encadré permet d’évaluer la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé de l’exploitant ou du salarié qui se trouve en arrêt de travail. Cet essai peut être effectué dans l’exploitation de l’assuré ou dans une autre entreprise.
L’essai encadré intervient à l’initiative de l’assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social de la Mutualité sociale agricole (MSA), avec l’accord notamment de son médecin traitant. Mais ce dispositif peut également lui être proposé, notamment par le service de santé au travail en agriculture de la MSA.
Durant l’essai encadré, dont la durée maximale est de 14 jours ouvrables renouvelable dans la limite de 28 jours ouvrables, l’assuré continue de percevoir (comme pendant son arrêt de travail) des indemnités journalières de la MSA et, le cas échéant, des indemnités complémentaires de la part de son employeur. Autrement dit, l’exploitation auprès duquel l’assuré effectue un essai encadré n’a pas à le rémunérer à ce titre.
Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-16825

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à ce dispositif. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement :- aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;- et aux salariés (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Concrètement, il convient de se référer, notamment, au poste occupé par le salarié, à l’organisation de son emploi du temps et aux responsabilités qui lui sont confiées pour apprécier son autonomie. Et non pas à la taille de l’entreprise, comme vient de le préciser la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une salariée cadre recrutée en tant que vétérinaire et soumise à un forfait-jours avait été licenciée pour inaptitude. Elle avait saisi la justice afin de contester la validité de ce forfait et ainsi obtenir, entre autres, le paiement d’heures supplémentaires. Elle estimait, en effet, ne pas avoir disposé de l’autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps pour se voir appliquer un forfait-jours notamment car elle avait été contrainte de se conformer aux horaires d’ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Grenoble n’avait pas fait droit à sa demande. Selon les juges, compte tenu de la taille réduite du cabinet (qui comptait seulement la présence d’une assistante vétérinaire ou d’une autre vétérinaire), la salariée n’avait pas été contrainte de se soumettre à un horaire collectif. Il en résultait qu’elle avait, à juste titre, pu se voir appliquer un forfait-jours.
Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Pour elle, l’autonomie de la salariée, et donc la validité du forfait-jours auquel elle était soumise, ne peuvent pas être appréciées en fonction de la taille du cabinet. Il reviendra donc, de nouveau, aux juges d’appel de se positionner sur l’autonomie réelle de la salariée au regard de critères plus pertinents…
Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-21748

Un créancier est en droit de demander en justice qu’un commerçant soit placé en redressement ou en liquidation judiciaire même après que ce dernier a cessé son activité. Dans ce cas, cette demande doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la radiation du commerçant au registre du commerce et des sociétés (RCS).
À ce titre, dans une affaire récente, un commerçant avait cessé son activité le 11 mars 2019, sa radiation au RCS étant intervenue le 5 août suivant. Son extrait Kbis indiquait bien une radiation au 5 août 2019 mais « avec effet au 11 mars 2019 ». Du coup, la question s’est posée de savoir si le point de départ du délai d’un an était la date de la mention de la radiation au RCS (5 août 2019) ou bien la date d’effet de celle-ci (11 mars 2019).
En effet, l’un des créanciers de ce commerçant l’avait assigné en redressement judiciaire le 15 juillet 2020. Ce dernier avait alors fait valoir que cette demande était hors délai puisqu’il avait cessé son activité depuis plus d’un an. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison. Pour elle, le délai d’un an court à compter de la date à laquelle la radiation est inscrite au RCS (en l’occurrence le 5 août 2019), peu importe le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation avec effet à une date antérieure (en l’occurrence au 11 mars 2019), « cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers ». L’assignation du créancier était donc recevable.
Attention : cette solution ne s’applique qu’aux personnes physiques exerçant une activité commerciale. Pour les personnes physiques exerçant une activité artisanale, agricole ou libérale, c’est la date de cessation d’activité qui fait courir le délai d’un an. Et pour les sociétés, c’est la date de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation qu’il faut prendre en compte.
Cour d’appel de Paris, 10 octobre 2022, RG n° 21/12989

Les associations et les fondations peuvent vouloir investir leurs excédents de trésorerie dans des placements afin de générer des intérêts. Mais la prudence est de mise, comme le montre une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Paris.
Ainsi, une fondation reconnue d’utilité publique dotée d’un patrimoine très important avait conclu une convention de prestation de services avec une société de conseil en vue de réaliser plusieurs investissements. Celle-ci avait notamment mis en place un fonds d’investissement de droit luxembourgeois sur lequel la fondation s’engageait à effectuer un dépôt initial de 10 millions d’euros, puis un versement de 215 millions d’euros réparti en 12 mensualités.
Alléguant des retards dans l’exécution de ses obligations par la fondation, la société de conseil lui avait indiqué qu’elle mettait fin à la convention de prestation de services. La fondation avait alors réclamé le remboursement des sommes qu’elle avait déjà remises à la société de conseil.
Le tribunal de commerce de Paris avait annulé la convention de prestation de services et ordonné à la société de conseil de restituer à la fondation plus de 1,34 million d’euros. Ce jugement ayant été contesté par la société, le litige a été porté devant la Cour d’appel de Paris.
Pour la cour d’appel, la fondation devait être considérée comme un investisseur non professionnel. En effet, selon le Code monétaire et financier, « un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Or, puisque la fondation avait pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et que ses ressources provenaient de dons, les juges ont estimé que « les règles de la finance lui étaient étrangères ».
Constatant un défaut de conseil et un comportement déloyal de la part de la société à l’égard d’un investisseur non professionnel, la cour d’appel a annulé la convention de prestation de services et a condamné la société à restituer à la fondation les sommes qui lui avaient été versées.

Le gouvernement a présenté le bilan de la lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale pour l’année 2022. Et ce ne sont pas moins de 10,6 milliards d’euros d’impôts qui ont été encaissés l’an dernier par l’État à la suite des contrôle fiscaux, un niveau équivalent à celui de 2021. Sachant que ce montant concerne principalement l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires.
Dans le détail, 14,6 milliards d’euros d’impôts (droits et pénalités) ont été réclamés en 2022 auprès des particuliers et des entreprises, dont 8,8 milliards d’euros au titre des opérations de contrôle sur place, essentiellement dans les entreprises. Un montant en hausse de 13 % par rapport à 2021 (+1 milliard d’euros). 5,8 milliards d’euros sont issus des contrôles sur pièces, c’est-à-dire réalisés à distance depuis les bureaux de l’administration fiscale.
Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 8,2 % en un an (13,4 milliards d’euros en 2021). Ce résultat s’explique notamment par le renforcement du ciblage des contrôles fiscaux via l’analyse de données. En effet, 52 % des contrôles des entreprises ont été engagés grâce au datamining en 2022. En outre, 2 milliards d’euros ont été mis en recouvrement à partir de dossiers ciblés par le datamining au cours des années précédentes.
Précision : l’accompagnement des contribuables de bonne foi s’est poursuivi en 2022. Ainsi, près de 45 % des contrôles sur pièces se sont terminés par des régularisations en cours de contrôle, soit 47 000 dossiers (contre 43 000 en 2021).
BOI-BIC-CHAMP-70-10 du 23 novembre 2022

Les entrepreneurs individuels relèvent désormais d’un nouveau statut qui sépare leurs patrimoines personnel et professionnel. Ce nouveau statut étant applicable quelles que soient leur activité.
Précision : l’administration fiscale a précisé que les membres des professions libérales réglementées exerçant en nom propre relèvent également de ce statut.
Dans ce cadre, les entrepreneurs individuels qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent choisir d’être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Une option qui entraîne néanmoins des conséquences fiscales.
Ainsi, lorsque cette option est exercée, non pas au moment de la création de l’entreprise, mais ultérieurement, elle entraîne, d’une part, le transfert des biens du patrimoine de l’entreprise individuelle vers celui de l’entreprise assimilée à une EURL et, d’autre part, la cessation de l’entreprise individuelle.
À noter : lorsque l’option est exercée au moment de la création de l’entreprise, le transfert des biens, qui sont utiles à l’exercice de l’activité, du patrimoine personnel de l’entrepreneur vers le patrimoine professionnel de l’entreprise assimilée à une EURL n’est pas immédiatement imposable. Cette imposition étant reportée au moment de l’éventuelle cession ultérieure de ces biens.
Ce transfert des biens donne lieu à la constatation de plus ou moins-values professionnelles. À ce titre, l’administration fiscale admet qu’en cas de plus-values professionnelles, l’exonération en fonction des recettes et, pour les plus-values immobilières, l’abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5, peuvent s’appliquer.
Attention : le report d’imposition des plus-values peut également s’appliquer, mais, dans ce cas, les régimes de faveur précités ne sont pas cumulables.
Quant à la cessation de l’entreprise individuelle, elle emporte taxation immédiate des bénéfices non encore imposés.
Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, JO du 14

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales sera encore plus encadré à compter du 1 mars prochain.
Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février

Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie.
Les bulletins de paie édités à compter du 1er juillet 2023 devront intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social. Celui-ci correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement des salariés (salaires, primes, avantages en nature, indemnités légales d’activité partielle, indemnités de congés payés…) duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires.
Précision : le montant net social constitue le montant que les allocataires doivent déclarer pour bénéficier notamment de la prime d’activité ou du RSA. Son inscription sur le bulletin de paie vise à simplifier leurs démarches auprès des organismes sociaux.
Art. 75, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

À compter de 2023, une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.
Précision : les locaux professionnels utilisés par les associations ou par les organismes privés poursuivant ou non un but lucratif sont soumis à cette taxe. Sont toutefois exonérés les locaux (et les surfaces de stationnement) appartenant aux fondations et aux associations reconnues d’utilité publique dans lesquels elles exercent leurs activités.
Cette taxe est due, en principe, par les propriétaires, les usufruitiers, les preneurs à bail à construction, les emphytéotes et les titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel de tels locaux, au 1 janvier de l’année d’imposition.
Le montant de la taxe est égal au produit de la superficie en mdes locaux concernés par un tarif variable en fonction de leur nature. En 2023, les tarifs au msont fixés à :- 0,94 € pour les bureaux ;- 0,39 € pour les locaux commerciaux ;- 0,20 € pour les locaux de stockage ;- 0,13 € pour les surfaces de stationnement.
À noter : ne sont pas taxables les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 met les surfaces de stationnement de moins de 500 m.
En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1 mars de chaque année auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. À titre dérogatoire, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration et le paiement sont à effectuer avant le 1 juillet 2023.
Rappel : une taxe similaire existe déjà en région Île-de-France.
Cassation civile 2e, 13 octobre 2022, n° 20-23133

Dans le cadre de leur affiliation à la MSA, les chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles relèvent du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Mais par dérogation, les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) exerçant une activité agricole relèvent du régime de Sécurité sociale des salariés agricoles.
C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une caisse de MSA avait adressé au président non rémunéré d’une SAS exerçant une activité agricole une contrainte relative à des impayés de cotisations sociales. L’intéressé avait alors contesté cette contrainte en justice, faisant valoir qu’il ne relevait pas du statut social des exploitants agricoles mais de celui des salariés agricoles. Les juges (la Cour de cassation, en l’occurrence) lui ont donné raison : en sa qualité de président d’une SAS, il était assimilé à un salarié agricole ainsi que la loi (article L 722-20-9° du Code rural) le prévoit. Le régime de protection sociale des exploitants agricoles lui était donc inapplicable.
À noter : les juges avaient déjà estimé, par le passé, que même s’il n’est pas rémunéré, le président d’une société par actions simplifiée (SAS) exerçant une activité agricole relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et non du régime des exploitants agricoles.
Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023, JO du 27

Afin d’inciter les entreprises à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, le gouvernement a mis en place un système de bonus-malus de la contribution patronale d‘assurance chômage. Ce dispositif s’applique depuis septembre 2022 dans les entreprises d’au moins 11 salariés relevant de sept secteurs d’activité. Et il perdurera au moins jusqu’au 31 août 2024.
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, communiqué de presse n° 614 du 16 février 2023

Depuis le 1 janvier dernier, les formalités des entreprises doivent, en principe, obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet .
Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.
Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.
Or, vous le savez sûrement, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Du coup, a été temporairement réouverte pour permettre d’y accomplir un certain nombre de formalités, notamment les formalités de modification et de radiation des sociétés civiles, des sociétés d’exercice libéral, des personnes morales assujetties à l’immatriculation au RCS ne relevant ni des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ni des Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA), des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), des groupements d’intérêt économique (GIE) et des groupements européens d’intérêt économique (GEIE).
Et dans un communiqué de presse du 16 février dernier, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé que les formalités de modification et de cessation, comportant une inscription au registre du commerce et des sociétés, des sociétés commerciales, artisanales et agricoles peuvent également être accomplies provisoirement sur le site Infogreffe.
Précision : ces formalités pourront être effectuées sur le site Infogreffe entre le 20 février et le 30 juin 2023.

Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique AGORA géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site , vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.
Sont rendus publics via ce répertoire notamment le nom et les coordonnées de l’association, l’identité de ses dirigeants et des personnes chargées de la représentation d’intérêts, le niveau d’intervention (local, national, européen et/ou mondial), les secteurs d’activité dans lesquels elle est exercée (économie, éducation, emploi, environnement, santé, solidarité, justice, recherche, sports, loisirs, tourisme...), leurs actions de représentation d’intérêts ainsi que les moyens alloués à ces actions.
En chiffres : mi-février 2023, 2 600 structures, dont 19,7 % sont des associations, étaient inscrites sur ce répertoire numérique.

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
Cassation commerciale, 25 janvier 2023, n° 21-15772

Une société à responsabilité limitée (SARL) peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Ces derniers sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les personnes étrangères à la société (les « tiers ») des infractions à la loi ou aux règlements, des violations des statuts ou encore des fautes commises dans leur gestion. Sachant que lorsque plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer, pour la première fois semble-t-il, que la pluralité de gérants dans une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.
Dans cette affaire, la cogérante d’une SARL exploitant un supermarché dans un centre commercial exploitait également un restaurant dans ce même centre. Quelque temps avoir quitté la SARL, elle avait vu sa responsabilité pour faute de gestion engagée par la société. En effet, cette dernière lui reprochait de lui avoir fait supporter des factures d’électricité qui étaient dues par son restaurant. L’ex-gérante avait alors fait valoir que l’action en responsabilité aurait dû être engagée non pas contre elle seulement, mais contre tous les cogérants. Les juges n’ont donc pas été de cet avis : la SARL pouvait valablement agir en responsabilité contre l’ex-gérante pour des fautes commises dans sa gestion quand bien même y avait-il plusieurs gérants.
Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-13699

Bien souvent, un contrat de travail à durée indéterminée débute par une période d’essai. Et si cette période ne suffit pas à l’employeur pour apprécier les aptitudes du nouvel embauché, elle peut être renouvelée une fois. Mais à condition que ce renouvellement soit prévu par un accord de branche étendu (qui en fixe la durée et les modalités) et par le contrat de travail du salarié. Et ce n’est pas tout, il faut aussi obtenir l’accord du salarié. Sachant que lorsqu’un doute subsiste en la matière, les juges vérifient que la volonté du salarié de renouveler sa période d’essai est claire et non équivoque…
Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que directeur des ressources humaines par un contrat de travail qui prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable. Il avait ensuite signé une lettre actant le renouvellement de sa période d’essai. Environ un mois plus tard, son employeur lui avait notifié la rupture de sa période d’essai.
Le salarié avait alors saisi la justice en vue de contester le renouvellement de sa période d’essai (et donc d’obtenir la requalification de la rupture de la période d’essai en licenciement abusif). Il estimait en effet qu’il n’avait pas accepté ce renouvellement de manière claire et non équivoque.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Versailles a constaté que la lettre de renouvellement signée par le salarié ne contenait aucune mention (comme la mention « lu et approuvé ») permettant de s’assurer de sa volonté claire et non équivoque. Elle a toutefois relevé que le salarié avait adressé des mails à plusieurs recruteurs dans lesquels il indiquait que sa période d’essai avait été renouvelée. Pour les juges, ces mails prouvaient que le salarié avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement. Les juges n’ont donc pas fait droit à la demande du salarié.
Conseil : afin d’éviter une contestation du salarié, l’employeur a tout intérêt à lui faire signer une lettre de renouvellement de la période d’essai comportant la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-19841

Contrairement au contrat à durée indéterminée (CDI), le contrat à durée déterminée (CDD) doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit comportant les signatures de l’employeur et du salarié. À défaut de ces deux signatures, le CDD peut être requalifié en CDI par les juges.
À ce titre, si la signature manuscrite et la signature électronique sont admises, qu’en est-il de la signature manuscrite scannée sur le contrat de travail ?
Dans une affaire récente, un salarié recruté en CDD saisonnier avait demandé en justice la requalification de ce contrat en CDI. Selon lui, le contrat n’avait pas été régulièrement signé par son employeur puisqu’il contenait une signature manuscrite scannée.
Saisies de l’affaire, la Cour d’appel d’Angers, puis la Cour de cassation, ont estimé qu’une signature dont l’image est reproduite sur le contrat de travail ne constitue ni une signature manuscrite ni une signature électronique. Mais que cette signature numérisée est tout de même valable, dès lors qu’il est possible d’identifier son auteur (dans cette affaire, le gérant de la société) et que celui-ci est bien habilité à signer le contrat de travail. La demande de requalification du contrat de travail a donc été rejetée.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, brochure du 13 janvier 2023

Le guide 2022 du crédit d’impôt recherche (CIR) a été publié sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Un guide qui se décline, cette année, en deux versions : le guide intégral et le focus agrément.
Rappel : les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les dépenses d’innovation exposées par les PME ouvrent droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.
Dépourvu de valeur règlementaire, ce guide est établi afin d’aider les entreprises qui bénéficient du CIR et du dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) à préparer leur déclaration, déposer un rescrit ou encore demander un agrément. Il se concentre sur les activités de recherche et développement (R&D). Les dépenses d’innovation étant traitées en annexe. Sont notamment présentés les dépenses éligibles, l’assiette et le calcul du CIR. À ce titre, le guide tient compte de la suppression au 1 janvier 2022 du doublement d’assiette en cas de travaux de R&D sous-traités à des entités publiques.
Comme habituellement, le guide donne aussi de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur ces avantages fiscaux. Et une annexe a été ajoutée afin d’intégrer le nouveau crédit d’impôt à destination des entreprises qui engagent des dépenses dans le cadre d’un contrat de collaboration avec les organismes de recherche et de diffusion des connaissances.
À noter : le montant du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative est fixé à 40 % des dépenses facturées - minorées de certaines aides – retenues dans la limite globale annuelle de 6 M€. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan annuel < 43 M€).
Le guide dispense également un certain nombre de préconisations aux entreprises pour constituer le dossier justificatif des travaux de recherche qui est demandé par l’administration fiscale en cas de contrôle du CIR et renvoie vers un modèle. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.
En pratique : ce dossier permet, outre de présenter ses travaux à l’administration lors d’un contrôle, de remplir plus facilement sa déclaration de CIR et de soutenir une demande de remboursement.

Une nouvelle fois, le ministère de l’Agriculture vient d’ouvrir un guichet d’aide aux investissements destinés à protéger les exploitations agricoles contre les aléas climatiques. Doté d’un budget de 40 millions d’euros, il sera ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. Les demandes pour bénéficier d’une aide en la matière devront donc être formulées au plus tard à cette date. Mais attention, elles ne pourront être satisfaites que dans la limite des crédits disponibles.
À noter : peuvent bénéficier de ces aides les exploitants agricoles exerçant à titre individuel, les Gaec, les EARL, les SCEA, les Cuma ainsi que les associations syndicales autorisées (ASA) intervenant pour l’irrigation collective.
Décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023, JO du 4

Le ministre de l’Économie et des Finances l’a annoncé le lundi 13 février dernier : l’indemnité carburant de 100 €, instaurée pour les Français les plus modestes pour préserver leur pouvoir d’achat, pourra être demandée jusqu’à la fin du mois de mars, et non pas jusqu’au 28 février comme c’était initialement prévu. Le but étant de permettre à la moitié des foyers éligibles qui n’ont pas encore fait la demande (à la date à laquelle ces lignes étaient écrites) de pouvoir profiter de l’aide.
Rappel : cette indemnité succède à la remise à la pompe de 10 centimes d’euros par litre, qui a pris fin le 31 décembre 2022. Mais contrairement à cette dernière, qui bénéficiait à tous, elle est ciblée car elle est destinée aux 10 millions de Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule (voiture, deux-roues) pour se rendre à leur travail.
Rappel des conditions pour bénéficier de cette aide.
Cassation commerciale, 4 janvier 2023, n° 21-10035

Très souvent, dans les sociétés, les statuts prévoient qu’en cas de cession de parts sociales ou d’actions par un associé, le cessionnaire proposé par ce dernier devra être agréé par les autres associés. Et qu’à défaut d’agrément, la société devra racheter les parts sociales ou les actions considérées.
À ce titre, dans une affaire récente, l’un des deux associés d’une société par actions simplifiée (SAS), qui souhaitait quitter la société et donc vendre ses actions, avait demandé l’agrément du cessionnaire qu’il proposait. Les statuts prévoyaient dans ce cas que le cessionnaire devrait être agréé par l’assemblée générale et qu’en cas de refus d’agrément et à défaut de rachat des actions par la société dans un délai de 2 mois, l’agrément serait réputé acquis.
La société ayant refusé d’agréer le cessionnaire, elle avait proposé à l’associé cédant de racheter ses actions. Elle avait alors demandé en justice la mise sous séquestre de ces actions ainsi que la désignation d’un expert pour déterminer leur valeur. Ce dernier avait remis son rapport 19 mois plus tard et la SAS avait finalement refusé de racheter les actions. Mécontent, l’associé cédant avait agi en justice contre la SAS. Mais la cour d’appel avait rejeté son action car, selon elle, puisque la SAS n’avait pas racheté les actions dans le délai de 2 mois, l’agrément du cessionnaire proposé par l’associé était réputé donné et ce dernier pouvait donc lui vendre ses actions comme prévu.
Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a constaté qu’après avoir refusé l’agrément, la société avait manifesté son intention de racheter les actions au prix fixé par un expert, ce que l’associé cédant avait accepté, et qu’il y avait donc eu accord sur la chose et sur les modalités de détermination du prix. La SAS ne pouvait donc pas revenir sur cet accord et était donc tenue de racheter les actions.
Conseil constitutionnel, 25 novembre 2022, n° 2022-1026 QPC

En Île-de-France, les associations qui construisent, reconstruisent ou agrandissent des locaux à usage de bureaux doivent verser une taxe. En sont toutefois exonérés, notamment, les associations reconnues d’utilité publique et les services publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.
À ce titre, dans une affaire récente, une association simplement déclarée construisant une crèche prétendait que les articles du Code de l’urbanisme relatifs à cette taxe méconnaissaient les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en ce qu’ils y soumettaient les associations non reconnues d’utilité publique ayant une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.
Mais, pour le Conseil Constitutionnel, l’assujettissement de ces associations à la taxe sur les bureaux est conforme à la Constitution puisque des personnes placées dans des situations différentes peuvent être traitées différemment au regard de l’impôt.

Depuis le 1 janvier 2023, l’Urssaf collecte les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav). Sont notamment concernés les architectes, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues, les diététiciens, les moniteurs de ski ou bien encore les guide-conférenciers.
Précision : les libéraux doivent régler leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès auprès de l’Urssaf en même temps que les autres cotisations (cotisations d’assurance maladie-maternité, d’indemnités journalières et d’allocations familiales, CSG-CRDS), c’est-à-dire soit mensuellement (au plus tard le 5 ou le 20 de chaque mois), soit trimestriellement (au plus tard les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre).
Infogreffe, communiqué du 13 janvier 2023
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, communiqué du 16 janvier 2023
Greffe du Tribunal de commerce de Paris, communiqué du 27 janvier 2023

Depuis le 1 janvier dernier, les formalités des entreprises doivent obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet .
Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.
Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.
Or, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Aussi, une procédure de secours a-t-elle été activée. Ainsi, l’ancien site est temporairement maintenu en service, tout au moins pour les formalités de modification.
Et la plate-forme est temporairement réouverte pour permettre d’y accomplir les formalités suivantes, lesquelles peuvent également être effectuées par voie papier auprès des greffes compétents :- les formalités de modification et de radiation de certains groupements et de certaines sociétés, à savoir les sociétés civiles, les sociétés d’exercice libéral, les personnes morales assujetties à l’immatriculation au RCS ne relevant ni des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ni des Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA), les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), les groupements d’intérêt économique (GIE) et les groupements européens d’intérêt économique (GEIE) ;
Attention : la possibilité d’effectuer ces formalités sur Infogreffe.fr ou par voie papier est ouverte au déclarant uniquement lorsque la formalité n’est pas disponible sur le site guichet-entreprises ou en cas d’inaccessibilité à ce site.
- les déclarations des bénéficiaires effectifs isolées, c’est-à-dire effectuées indépendamment de toute autre formalité déclarative au RCS, et les dépôts d’actes isolés, c’est-à-dire non liés à une formalité déclarative.
Arrêté du 3 février 2023, JO du 5

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.
Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.
La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2023 vient d’être dévoilée. Aucun pays figurant dans la liste de l’an dernier n’a été retiré. Sont donc conservés Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges britanniques, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, le Panama, les Seychelles et les Palaos. En revanche, deux pays font leur entrée, à savoir les Bahamas ainsi que les Îles Turques et Caïques.
Au total, la liste compte donc, pour 2023, 14 pays.
En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux s’applique aux États et territoires nouvellement ajoutés à la liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de l’arrêté, c’est-à-dire, au cas présent, à partir du 1 mai 2023.
Projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023, n° 760

Chose promise, chose due : le gouvernement s’attelle, en ce début d’année, à un chantier de taille. Et c’est dans le cadre d’une loi de financement rectificative de la Sécurité sociale qu’il entend réformer en profondeur le système de retraite français. Actuellement dans les mains du Parlement, ce projet de loi prévoit, en particulier, de repousser l’âge légal de départ à la retraite et d’allonger la durée de cotisation requise pour obtenir une pension à taux plein. Explications.
À noter : par durée de cotisation, il faut entendre l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière.
Arrêté du 7 septembre 2022, JO du 22 janvier 2023

Entre 40 000 et 50 000 personnes, dont un tiers a moins de 55 ans, décèdent chaque année d’un arrêt cardiaque en France. Le taux de survie étant seulement de 3 % à 4 %, faute pour les Français de connaître les comportements qui sauvent.
Face à cet enjeu de santé publique, le gouvernement souhaite former la population aux gestes qui sauvent. Et les employeurs sont mis à contribution.
Ainsi, ils doivent désormais proposer aux salariés, avant leur départ à la retraite, des « actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent ».
Précision : cette action de sensibilisation doit se dérouler pendant les heures de travail et les employeurs doivent maintenir la rémunération des salariés.
Ces actions doivent permettre aux salariés d’acquérir les compétences nécessaires pour :- assurer leur propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;- réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;- réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.
Un récent arrêté précise les organismes et professionnels autorisés à dispenser cette formation. Il s’agit notamment des formateurs des services d’incendie et de secours, des associations agréées et organismes habilités à la formation aux premiers secours ainsi que de certains professionnels de santé (médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers…).
À noter : pour les salariés déjà formés au secourisme (titulaires depuis moins de 10 ans du certificat de sauveteur-secouriste du travail, du certificat de prévention et secours civique de niveau 1, du certificat d’acteur prévention secours du transport routier de voyageurs ou d’acteur prévention secours-aide et soin à domicile…), l’action de sensibilisation prend la forme d’une information transmise par tout moyen sur l’importance de maintenir à jour ses compétences.

Pour répondre aux difficultés de trésorerie rencontrées actuellement ou prochainement par nombre d’entreprises compte tenu du contexte de crise énergétique que nous connaissons, le Gouvernement a prolongé, par le biais d’un accord signé avec la Banque de France et les établissements bancaires, l’accord de place sur les restructurations des prêts garantis par l’État (PGE) jusqu’à la fin de l’année 2023. Rappelons que ce dispositif, qui avait été mis en place en janvier 2022, peut permettre à une entreprise en difficulté de rééchelonner son PGE sur 8 ou 10 ans, alors que sa durée est de 6 ans normalement, et donc de bénéficier de 2 voire de 4 années supplémentaires pour le rembourser, tout en continuant à bénéficier de la garantie de l’État. Plus précisément, il est ouvert aux entreprises qui ont obtenu un PGE d’un montant n’excédant pas 50 000 €.
La procédure de rééchelonnement est rapide, gratuite, confidentielle et non-judiciaire. Elle se déroule sous l’égide d’un tiers indépendant en la personne du médiateur du crédit aux entreprises (institution relevant de la Banque de France et chargée de débloquer le dialogue entre une entreprise et sa banque en cas de difficulté d’accès au crédit).
En pratique, pour pouvoir bénéficier de la mesure d’étalement des remboursements, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur banque, accompagnées de leur expert-comptable qui aura établi une attestation selon laquelle l’entreprise considérée n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement du PGE, puis à saisir . L’étude des dossiers se fera au cas par cas et c’est le médiateur qui donnera ou non son feu vert.
À noter : selon le ministère de l’Économie et des Finances, plus de deux ans et demi après le lancement des PGE, un tiers du montant des prêts octroyés ont d’ores et déjà été remboursés. Et dans leur grande majorité, les entreprises ont fait face en 2022 au remboursement de leur PGE sans difficulté. Le dispositif de rééchelonnement des PGE a permis d’accompagner environ 260 entreprises en 2022 en leur permettant d’étaler leur PGE sur une durée de 2 à 4 années supplémentaires par rapport à l’échéancier initial, avec maintien de la garantie de l’État.
Cassation civile 3e, 26 octobre 2022, n° 21-17886

Lorsqu’un exploitant agricole met les terres qu’il loue à la disposition d’une société, il est tenu d’en informer le bailleur, par lettre recommandée, dans les 2 mois qui suivent la réalisation de l’opération.
Précision : l’avis adressé au bailleur doit mentionner le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition.
Sachant que la sanction encourue par l’exploitant qui s’abstient d’envoyer cet avis à son bailleur est peu dissuasive. En effet, si la résiliation de son bail est encourue dans ce cas, ce n’est que s’il n’adresse pas cet avis au bailleur dans l’année qui suit la mise en demeure envoyée par ce dernier et si ce manquement entraîne un préjudice pour le bailleur. Autant dire qu’il y a très peu de chances qu’elle soit prononcée…
Mais attention, car les juges viennent de considérer que le défaut d’information du bailleur quant à la mise des terres louées à la disposition d’une société constitue un manquement de l’exploitant locataire à ses obligations, ce qui le prive du droit de céder son bail. Car, ont-ils rappelé, la faculté de céder le bail est réservée au locataire de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui s’est acquitté de toutes les obligations résultant de son bail.
Dans cette affaire, un agriculteur avait mis les terres qu’il louait à la disposition d’une société dans laquelle il entendait exercer son activité sans en avoir avisé le bailleur. Plusieurs années après, lorsqu’il avait demandé au bailleur l’autorisation de céder son bail à son fils, ce dernier avait refusé. En effet, selon lui, l’exploitant devait être déchu de son droit de céder son bail en raison du manquement qu’il avait commis de ne pas l’avoir informé en son temps de la mise à disposition. Les juges lui ont donc donné raison.
À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel le manquement du locataire à son obligation d’information du bailleur n’aurait causé aucun préjudice à ce dernier n’a pas été pris en compte par les juges.